
Sur les traces des sorcières d'Alsace : entre histoire sanglante et légendes persistantes
À l'approche d'Halloween, l'Alsace révèle sa face obscure. Loin des décorations fantaisistes, la région garde en mémoire une histoire profondément ancrée : celle des chasses aux sorcières, qui firent de ce territoire l'un des plus meurtriers d'Europe entre le XVe et le XVIIe siècle. Pour qui possède des racines alsaciennes, cette histoire n'est pas qu'une légende ; c'est une page sombre qui hante encore les archives et les pierres des villages.
L'Alsace, terre de feu et de procès expéditifs
Intégrée au Saint-Empire romain germanique, l'Alsace fut le théâtre d'une répression d'une violence extrême. On estime que près du quart des exécutions pour sorcellerie en Europe eurent lieu dans les territoires germaniques, et l'Alsace, avec ses nombreuses seigneuries et évêchés indépendants, compta parmi les épicentres de cette terreur.
Des villes comme Sélestat, Molsheim, Obernai ou Rouffach organisèrent des bûchers collectifs. La région était alors considérée comme infestée de sorcières par les inquisiteurs. Le processus judiciaire était implacable : une simple rumeur, une querelle de voisinage, un malheur inexpliqué (comme la mort du bétail) suffisaient à envoyer une personne – le plus souvent une femme, veuve, âgée et marginale – en prison. La torture (« la question ») était systématiquement employée pour arracher des aveux de pacte diabolique ou de sabbat. L'issue était presque toujours la condamnation au bûcher.

Les lieux qui racontent : des pierres chargées de mémoire
Aujourd'hui, l'Alsace assume ce passé à travers des lieux emblématiques où l'histoire et la légende se mêlent.
- La Tour des Sorcières de Ribeauvillé : Cette tour médiévale du XIIIe siècle, en grès rose, serait un ancien lieu de détention pour les accusées. Elle est aujourd'hui le point central de la fête de la « Sorcière Catillon » lors du carnaval.
- La Maison des Sorcières (S’Haxahus) à Bergheim : Ce lieu mémoire témoigne des procès expéditifs du XVIe et XVIIe siècles où près d'une quarantaine de femmes furent brûlées. Elle invite à réfléchir sur l'intolérance et l'exclusion.
- Le Château du Haut-Kœnigsbourg : Les légendes racontent que ses environs étaient le théâtre de rituels mystiques et que des murmures étranges y résonnent encore.
- L’Œil de la Sorcière à Thann : Cette formation rocheuse étrange était, dit-on, un lieu de rituels où les sorcières se connectaient aux forces de la nature.
- Le Mont Sainte-Odile : Entouré de mystère, on prétend que des lumières étranges, signes de forces surnaturelles, y apparaissent la nuit.
Des légendes qui persistent : de la fée bienveillante à la malédiction
Au-delà de l'histoire, le folklore alsacien est riche de récits qui perpétuent la mémoire de la sorcellerie sous un angle plus fantastique.
- La Fée Morgane d’Orbey : Une sorcière bienveillante qui, selon la légende, vivait dans la forêt pour apporter guérison et protection aux habitants.
- Le Sortilège du Château de Kintzheim : Rendu invisible aux mortels par un sort jeté par une sorcière, il disparaîtrait parfois mystérieusement.
- Les Sorcières de la Petite-Pierre : Une société secrète de sorcières aurait élu domicile dans ce village des Vosges du Nord pour y pratiquer des cérémonies nocturnes.
- La Malédiction de la Forêt d’Erstein : Une sorcière maléfique y aurait jeté une malédiction condamnant les imprudents qui s'y aventurent à subir des événements tragiques.
- La Sorcière de Molsheim : La légende de Mathilde, une sorcière aux pouvoirs ambivalents, qui protégeait la communauté tout en jetant des sorts à ses ennemis.
De la mémoire au folklore : la Fête des Sorcières de Rouffach
Aujourd'hui, cette histoire tragique est commémorée et réinterprétée through des événements populaires. La Fête des Sorcières à Rouffach en est le parfait exemple. Initialement liée au carnaval alsacien qui célèbre la fin de l'hiver, elle a désormais lieu en juillet. Au programme : un grand spectacle de feu et un rituel où un personnage de sorcière est "jugé" par la foule pour ses méfaits. Cette reconstitution, aussi festive soit-elle, est une manière de se réapproprier et d'exorciser collectivement le souvenir des procès injustes.
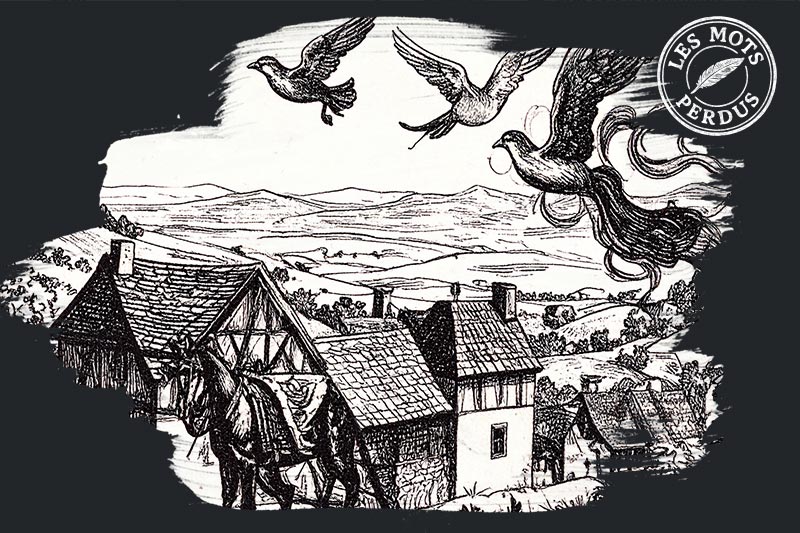
Pour le généalogiste alsacien : une quête poignante
Pour celui qui fouille son histoire familiale en Alsace, il est impossible d'ignorer cette page sombre. Retrouver la trace d'une ancêtre victime de cette chasse est rare mais poignant. Les indices se cachent dans les registres paroissiaux (une mention en marge d'un acte de sépulture), les archives judiciaires des prévôtés ou les chroniques locales.
Posséder des ancêtres alsaciens, c'est peut-être compter parmi eux une herboriste respectée, une femme indépendante crainte ou une innocente victime de la folie collective. À l'approche d'Halloween, se souvenir d'elles, c'est rendre hommage à celles dont la vie s'est achevée dans la cendre et honorer une mémoire qui refuse de s'éteindre.
Sur les traces de mes ancêtres alsaciens : le passé retrouvé des Miclo, Ancel et Schneider
Je porte en moi les paysages brumeux et les histoires enfouies de l'Alsace. Mes racines, ce sont celles des familles Miclo, Ancel et Schneider, qui ont battu le rythme de la vie aux Hauttes Huttes et Basses Huttes, sur les hauteurs d’Orbey, dans le Haut-Rhin. Ces noms, transmis par ma grand-mère maternelle, sont bien plus que de simples mentions sur un arbre généalogique ; ils sont le lien vivant avec une histoire familiale qui plonge profondément dans le terroir alsacien.
Remonter le fil du temps : jusqu'au XVIe siècle
Mon histoire familiale documentée commence aux alentours du XVIe siècle, une époque où l'Alsace appartenait encore au Saint-Empire romain germanique et où les registres paroissiaux commençaient tout juste à être tenus avec une certaine régularité. Franchir ce cap est une chance, mais c’est aussi là que commence le vrai travail de détective.
Au-delà de cette période, les traces se font plus rares, plus fragmentaires. Les archives, même numérisées et à portée de clic, deviennent un territoire difficile à conquérir. Le défi n'est pas seulement de les trouver, mais de pouvoir les déchiffrer : vieux allemand gothique, latin d'église, écritures tremblées sur parchemin usé par le temps… Chaque acte est une énigme paléographique qui demande patience, persévérance et une bonne dose d'intuition. C'est un travail passionnant, mais harassant, où chaque nouvelle découverte est une victoire.
La solidarité généalogique : l'indispensable guide
Dans cette quête solitaire, on découvre avec bonheur que l'on n'est jamais vraiment seul. Ma recherche aurait été bien plus ardue sans l'aide précieuse et désintéressée de mon cousin éloigné, Monsieur Guy Duportail.
Véritable puits de science et historien passionné de l'Alsace, son travail colossal sur Geneanet – un arbre qui regroupe pas moins de 82 400 individus – est une ressource inestimable. Il a patiemment reconstitué les ramifications de nombreuses familles de la région, créant un guide précieux pour tous ceux qui, comme moi, cherchent à comprendre d'où ils viennent. Son expertise et sa générosité à partager ses ressources et ses connaissances m'ont souvent guidé et évité de longues heures d'impasse. Il incarne cet esprit de partage qui fait la force de la communauté des généalogistes.
Entre histoire et mémoire : le poids des lieux
Connaître les noms et les dates, c'est une chose. Mais c'est en marchant sur les terres de mes ancêtres que l'histoire prend tout son sens. Se rendre aux Hauttes Huttes et Basses Huttes, imaginer la vie rude et laborieuse de ces familles de forestiers, d'artisans ou de cultivateurs dans ce vallon reculé, c'est leur redonner une part de réalité.
Cette région, marquée par les soubresauts de l'histoire entre France et Allemagne, mais aussi par les sombres épisodes des chasses aux sorcières, a forgé une identité unique. Savoir que mes aïeux ont vécu ici, qu'ils ont traversé ces épreuves, participe aujourd'hui pleinement de mon propre héritage identitaire.
Faire de la généalogie en Alsace, c'est bien plus que compiler des noms. C'est renouer avec la mémoire des siens, comprendre les épreuves qu'ils ont surmontées et honorer la persistance de leur trace, fragile mais bien réelle, dans le grand livre de l'Histoire.




